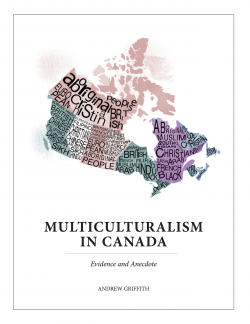Sigh although his concern regarding the excessive increases in temporary workers is legitimate and likely more political positioning. But a referendum on immigration, even if narrowly focused, will likely not be conducive to reasoned discussion:
Le premier ministre François Legault n’en peut plus d’entendre son homologue à Ottawa, Justin Trudeau, faire un « feu d’artifice d’annonces » prébudgétaires à l’intérieur des champs de compétence du Québec. Il invite le fédéral à se concentrer plutôt sur la hausse du nombre d’immigrants temporaires et ravive l’idée d’un référendum sectoriel en immigration.
« Au lieu de faire des annonces dans les champs de compétence du Québec, occupez-vous de vos propres responsabilités, en particulier l’immigration », a lancé l’élu caquiste, mardi, lors d’un point de presse tenu quelques minutes avant la période des questions, à l’hôtel du Parlement.
M. Legault réagissait à une série d’annonces effectuées dans les dernières semaines par lesquelles le gouvernement de Justin Trudeau a fait connaître ses intentions de débourser des milliards de dollars pour le logement. Il y a deux semaines, l’annonce de la création d’une Charte canadienne des locataires et de l’équivalent d’un bail uniforme pour tout le Canada avait fait fulminer les ministres du gouvernement Legault.
« Ce que je dis à M. Trudeau, c’est : écoutez les Québécois. Puis, au lieu de […] dire “on va vous donner de l’argent en santé, on va vous donner de l’argent pour le logement”, allez donc à la racine du problème. Il y a trop d’immigrants temporaires », a soutenu le premier ministre caquiste.
M. Legault reproche à son homologue au fédéral d’avoir « laissé exploser leur nombre à 560 000 », selon le dernier décompte. Après l’avoir écartée en février, le premier ministre revient donc avec l’idée d’un référendum sectoriel en immigration, en fonction du « résultat des discussions » avec son homologue, qui aboutiront à une rencontre au sommet sur le sujet d’ici la fin juin.
« On va rentrer dans le détail. Est-ce que les immigrants temporaires devraient être préapprouvés par le Québec ? Si c’était le cas, ça voudrait dire qu’un, on contrôlerait le nombre, et deux, on contrôlerait les exigences en français », a-t-il dit mardi. « Est-ce qu’on fait un référendum là-dessus éventuellement ? Est-ce qu’on fait un référendum plus large sur d’autres sujets ? »
Exclu, puis considéré
En février, pourtant, François Legault avait écarté un éventuel référendum sectoriel en immigration. « Je ne pense pas qu’on a besoin de faire un référendum pour demander aux Québécois s’ils souhaiteraient qu’on rapatrie les pouvoirs à Québec », avait-il dit.
Or, Justin Trudeau a une « obligation de résultat » en vue de sa réunion de juin, a fait valoir M. Legault mardi. Après une rencontre le mois dernier, le premier ministre québécois avait affirmé ressentir chez M. Trudeau une ouverture à ce que le Québec puisse décider du nombre de travailleurs temporaires admis sur son territoire et qu’une « partie » d’entre eux se voient refuser le renouvellement de leur permis de travail.
Sans quoi, « il faut voir, là, est-ce qu’on a besoin de faire un référendum pour s’assurer que la majorité des Québécois appuient », s’est interrogé M. Legault à voix haute.
À Ottawa, mardi, le ministre fédéral de l’Immigration, Marc Miller, a assuré que les discussions avec Québec allaient bon train. « J’ai vraiment senti dans les dernières semaines de la ministre [québécoise de l’Immigration Christine] Fréchette une ardeur au travail, une volonté de vraiment trouver des solutions à nos défis », a-t-il dit.
S’il convient avoir des « points de divergence » avec le gouvernement Legault, l’élu libéral entend oeuvrer sur « la langue commune du Québec » et sur le désir de Québec « de réduire les gens qui sont ici de façon temporaire ». L’idée de confier tous les pouvoirs en immigration au Québec comme l’avait demandé le gouvernement caquiste le mois dernier n’est toutefois pas sur la table.
« Un pays qui donne tous ses pouvoirs à quelqu’un d’autre n’est plus un pays », a-t-il maintenu.
Québec demandera des compensations sans conditions pour l’ensemble des programmes fédéraux s’immisçant dans les pouvoirs du Québec, a indiqué M. Legault mardi. « Il n’est pas question d’accepter ça. » Le dépôt du budget fédéral est prévu le 16 avril.
Source: Devant les annonces prébudgétaires d’Ottawa, Legault rebrandit le référendum en immigration
English version:
Premier François Legault on Tuesday threatened to hold a referendum on immigration if he doesn’t get what he wants from Prime Minister Justin Trudeau.
Legault is pressing Ottawa for more power over immigration. Trudeau slammed the door on giving the province full control last month. “Will we hold a referendum on (getting full power over immigration) eventually? Will we do it more broadly, on other subjects?” Legault said. “It will depend on the results of discussions” with the federal government. “Don’t forget, Mr. Trudeau promised me a meeting by June 30 at the latest. So, I expect results there.”
Speaking to reporters in Quebec City, Legault complained the province has received more than 500,000 temporary foreign workers and asylum seekers over the past eight years.
“The federal government has allowed the number of temporary immigrants to explode to 560,000,” he said.
“This causes enormous problems for Quebecers. We lack teachers, nurses, housing, and (immigrants and asylum seekers) pose a real challenge for the future of French, particularly in Montreal.”
Legault said a referendum is “not in our plan, short term.”
However, he added: “Do we need to hold a referendum so that Mr. Trudeau is convinced that a majority of Quebecers are saying that it doesn’t make sense (to allow) 560,000 immigrants” to come to Quebec.
He said Quebecers “have always been welcoming, will always be welcoming” toward immigrants. “But now we can’t do it anymore. Our capacity to receive has been exceeded.”
He said Trudeau recently admitted Canada has welcomed too many immigrants.
“It’s the first time he’s said that,” Legault noted.
Last week, Trudeau said temporary immigration has to be brought “under control.” He said the number of temporary foreign workers and international students has ”grown at a rate far beyond what Canada has been able to absorb.”
Legault said the problem could be solved if Ottawa granted Quebec the power to pre-approve all temporary immigrants. That way, Quebec could control the number of arrivals and set French language requirements, he said.
After a March 15 meeting with Legault, Trudeau said: “No, we are not going to give more power (to Quebec) on immigration. Quebec already has more powers over immigration than any other province because it’s very important to protect the French language.”
At the time, Legault said Trudeau has privately expressed openness to discussing the idea of giving Quebec a say on the admission of temporary workers and would consider new rules ensuring more workers speak French.
The Coalition Avenir Québec government is under pressure to crack down on immigration. The party’s most significant rival is the poll-leading Parti Québécois.
After last month’s Legault-Trudeau meeting, PQ Leader Paul St-Pierre Plamondon said Trudeau’s response proves Legault is unable to win more powers for Quebec.
“This resounding No is evidence of a completely absent level of bargaining power,” the leader of the pro-sovereignty party said at the time. “It’s embarrassing for Quebec. We deserve more than this perpetual humiliation.”
Source: Legault threatens immigration referendum if Trudeau doesn’t relent