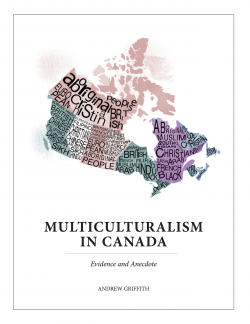Les établissements francophones ontariens eux aussi plus touchés par les rejets de permis d’études
2022/02/24 Leave a comment
Of note. Would really be helpful to have more in-depth analysis of the factors that underlie these differences, rather than just the differences:
Les établissements postsecondaires francophones et bilingues de l’Ontario peinent à recruter des étudiants étrangers. Leur taux de refus de permis d’études auprès d’Immigration Canada est de loin supérieur à ceux observés dans les collèges et universités anglophones, a constaté Le Devoir.
Des directions francophones disent devoir travailler beaucoup plus fort que leurs collègues anglophones pour pouvoir atteindre leur cible de recrutement. Les deux seuls collèges de langue française de l’Ontario ont vu respectivement 67 % et 73 % des demandes de permis d’études de leurs futurs étudiants être refusées en 2021, d’après des données fournies par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Il s’agit d’une amélioration par rapport à 2020, où la moyenne pour les deux s’élevait à 79 %. Dans les 22 collèges anglophones répertoriés dans la base de données d’IRCC, ce sont en moyenne 40 % des demandes qui ont été refusées en 2021 et 50 % en 2020.
L’écart est similaire entre les universités francophones et bilingues d’un côté, et celles anglophones de l’autre. À l’Université de Hearst, au nord de la province, par exemple, 72 % des demandes de permis d’études pour étudiants étrangers ont été déclinées en 2021 et 86 % l’année précédente. Quelque 85 % des demandes l’ont été au cours des deux dernières années à l’Université Laurentienne. À Thunder Bay, à l’Université Lakehead, la plus grande du nord de l’Ontario, un établissement anglophone, la situation est tout autre : en 2021, seulement 28 % des demandes de permis d’études ont été refusées.
Bululu Kabatakaka, le directeur des programmes postsecondaires et de l’intégration au collège Boréal, ne comprend pas ce qui cause cet écart. « Est-ce qu’il y a un biais inconscient par rapport aux pays francophones ? » se demande-t-il. Le Devoir révélait en novembre qu’Ottawa refusait de plus en plus d’étudiants de l’Afrique francophone.
Le dirigeant estime qu’il doit travailler considérablement plus fort que ses collègues pour atteindre ses cibles. « Quand nos collègues [d’autres collèges] travaillent 35 heures, nous, on travaille 150 heures », dit-il.
Le même phénomène se produit au collège La Cité d’Ottawa et à l’Université de Hearst. Le recteur de l’université, Luc Bussières, critique le gaspillage associé aux taux de refus élevés : des ressources sont dépensées inutilement pour le recrutement, et des rêves d’étudiants sont gâchés, dit-il. « Ça rendrait notre travail plus efficace si on avait un meilleur taux, explique le recteur. Si on veut 100 personnes, il faut faire 500 offres. »
« Nous devons généralement faire de 15 à 20 offres aux candidats pour que 10 étudiants acceptent notre offre et que 3 de ces étudiants obtiennent un permis d’études », raconte pour sa part Pascale Montminy, directrice des communications de La Cité. En 2021, 67 % des demandes de permis d’études au collège ont été refusées. À quelques kilomètres à l’ouest du centre-ville d’Ottawa, au collège Algonquin, qui est anglophone, le taux tombe à 40 %.Problème difficile à régler
Ce type de problème dure depuis environ quinze ans, estime Martin Normand, directeur de la recherche stratégique et des relations internationales à l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC). « Les établissements interpellent IRCC et ses prédécesseurs pour demander des explications et des modifications, ou à tout le moins plus de transparence », fait savoir le directeur.
Le gouvernement fédéral souhaite depuis 2003 que les immigrants francophones représentent 4,4 % des nouveaux arrivants à l’extérieur du Québec. L’échéancier pour atteindre la cible avait d’abord été fixé à 2008, mais il a ensuite été reporté de 15 ans. Pourtant, Martin Normand remarque que les agents du ministère « reprochent souvent aux étudiants leur intention de rester au Canada à la fin de leurs études », explique le directeur de l’association. L’intention de faire une demande de résidence permanente après les études constitue un motif de refus pour les permis d’études, soutient-il. Le directeur était du groupe de témoins qui ont récemment critiqué l’approche d’Ottawa, qu’ils estiment contradictoire, devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration.
Selon IRCC, même s’il existe une possibilité pour un étudiant étranger d’éventuellement devenir un résident permanent, chaque demandeur de permis doit convaincre l’agent d’immigration qu’il a l’intention de respecter ses obligations à titre de résident temporaire. Ainsi, chaque demandeur « doit être capable et désireux de quitter le Canada à la fin de sa période de séjour autorisé », explique Julie Lafortune, porte-parole du ministère, par courriel.
L’exercice d’analyse des établissements en ce qui concerne les motifs de refus est encore plus compliqué du fait du manque d’accès aux données. Lorsque contactées par Le Devoir au sujet des taux de refus, des directions ont dit ne jamais les avoir vues. « C’est un peu une boîte noire », lance Luc Bussières, recteur de l’Université de Hearst, qui compte entre 250 et 300 étudiants.De l’université au collège
Les étudiants détenant un diplôme universitaire dans leur pays natal seraient aussi désavantagés s’ils souhaitent retourner aux études dans un programme collégial en Ontario, estime Bululu Kabatakaka. Dans sa campagne de recrutement, le Collège Boréal évoque la pénurie de main-d’œuvre dans la province, qui touche certains secteurs couverts par ses programmes, mais si des candidats étudiants tentent de répondre à ce besoin, ils se voient bloquer par IRCC, affirme M. Kabatakaka.
Il s’agirait plutôt de juger de la « bonne foi » des demandeurs, fait valoir IRCC. La demande d’une personne détenant déjà un diplôme universitaire pour suivre des études dans un domaine non connexe « ne pourrait peut‑être pas convaincre l’agent qu’il est un étudiant de bonne foi », cite comme exemple la porte-parole Julie Lafortune.
« Il faut que les agents comprennent bien les besoins des communautés francophones en matière d’immigration et de main-d’œuvre », affirme de son côté Martin Normand, de l’ACUFC.
Source: Les établissements francophones ontariens eux aussi plus touchés par les rejets de permis d’études